...
Le 18, en me levant, le
malaise que j'avais éprouvé depuis la tempête que nous
avions essuyée dans le golfe du Lion était complètement
dissipé. La chaleur commençait à se faire sentir.
On sentait approcher les côtes d'Afrique. La mer était calme,
pas une seule vague. C'était comme un miroir, une vaste plaine d'étain
fondu. C'était beau. Vers le soir, nous aperçûmes les
côtes d'Afrique devant nous et les côtes d'Espagne à
tribord. Nous distinguions aussi la ville de Carthagène (Espagne).
Le 19, au réveil,
la mer était couverte d'un brouillard intense. L'on cargua toutes
les voiles afin de diminuer la vitesse du navire par crainte de collision
avec d'autres vaisseaux. Vers 10 heures, le brouillard s'enleva, le soleil
brilla dans toute sa splendeur. Il faisait 35 degrés de chaleur.
Le 20 à 4 heures du
matin, nous passâmes auprès de la ville de Gibraltar appartenant
aux Anglais. Quand le jour parut, nous vîmes parfaitement les côtes
du Maroc et les côtes d'Espagne tout près de nous. Nous passâmes
en vue de la ville de Cadix (Espagne). Nous étions en plein détroit
de Gibraltar. Le soir, nous entrions dans l'Océan Atlantique, laissant
l'Afrique à babord et le Portugal à tribord. Le vent était
violent, venant d'arrière. Le commandant de bord fit éteindre
les machines, les voiles suffisant, le vent étant favorable. Il
faisait un roulis épouvantable, le navire était balancé
comme une coque de noix, je croyais à chaque instant être
englouti mais ce n'était rien. Nous devions essuyer une tempête
plus formidable que celle-ci. Le vent dura toute la journée du 21
mais je ne fus pas malade cette fois, j'était déjà
fait au roulis.
Le 22, la mer était
plus calme. Le 23 il tomba de la pluie une partie de la journée.
Du 24 au 26, rien de remarquable, la mer était belle, la chaleur
intense. Nous commencions à souffrir de la soif, nous n'avions que
deux quarts d'eau de mer distillée par jour, qui était toute
chaude. Avec çà, nous mangions du lard salé, des fayots
et du biscuit, nourriture que nous eûmes durant tout le voyage et
encore, nous en avions pas assez, pas même pour apaiser notre faim,
les fayots remplis de petits cochons comme les lentilles en France, le
biscuit étant travaillé par les vers. Les bœufs que nous
avions emportés de France, leur chair était meurtrie par
le roulis, la viande ne valait absolument rien.
Ce n'était encore
que le commencement car nous devions encore souffrir devantage, n'étant
pas encore près d'être au terme de notre traversée.
Dans l'après-midi, nos aperçûmes à l'horizon
les côtes des îles Canaries. Deux heures après elles
avaient disparu à nos yeux. Nous ne voyions plus de terre, rien
que l'eau et le ciel. Nous devions être 28 à 30 jours sans
voir la terre. Depuis que nous avions qui le détroit de Gilbraltar,
nous n'avions marché qu'à la voile, le vent étant
favorable. Le temps était au beau et plus nous avancions plus la
chaleur devenait forte.
Nous marchâmes ainsi
jusqu'au 4 octobre. La chaleur redoublait d'intensité, il faisait
lourd, on sentait que nous ne serions pas longtemps sans avoir d'orage.
Il était impossible de rester cinq minutes exposé au soleil
sur le pont, on aurait été frappé d'insolation et
dans les batteries, on étouffait. Nous nous réfugiions où
nous pouvions, à l'ombre des mâts et des voiles. Je souffrais
horriblement de la soif. Je puis dire que je n'avais jamais enduré
pareille souffrance. J'étais comme fou.
[...]



 raison
que nous n'étions pas au bout de notre misère car nous devions
en souffrir bien d'autres pendant notre traversée sur ce sale transport
l'Orne.
raison
que nous n'étions pas au bout de notre misère car nous devions
en souffrir bien d'autres pendant notre traversée sur ce sale transport
l'Orne.
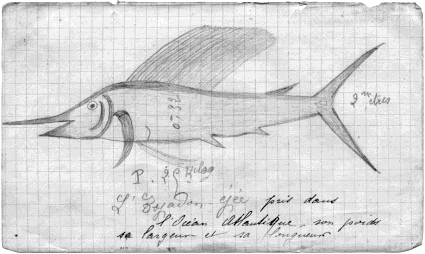 qui
pesait 25 kilos, ayant 2 mètres de longueur, dont 50 centimètres
en épée, espèce de lance que le poisson a au bout
du bec dont il se sert pour se défendre. La sentinelle placée
en vigie au haut du grand mât avait reçu l'ordre de veiller
à la terre devant. L'eau avait changé de couleur, de vert
elle était devenue jaune, couleur provenant des côtes qui
sont formées de sable.
qui
pesait 25 kilos, ayant 2 mètres de longueur, dont 50 centimètres
en épée, espèce de lance que le poisson a au bout
du bec dont il se sert pour se défendre. La sentinelle placée
en vigie au haut du grand mât avait reçu l'ordre de veiller
à la terre devant. L'eau avait changé de couleur, de vert
elle était devenue jaune, couleur provenant des côtes qui
sont formées de sable.
 Nous
croyions en arrivant à terre que nous avions très peu de
chemin à faire pour arriver à la caserne, mais la caserne
d'Orléans à la Basse-Terre était consignée
rapport aux fièvres. On nous emmena au Camp Jacob situé à
7 kilomètres de la Basse-Terre. Pour y arriver, il faut constamment
monter, toujours en tournant, car la Basse-Terre est au niveau de la mer
tandis que le Camp Jacob est élevé de 700 mètres au-dessus
du niveau de la mer. Depuis deux mois que nous n'avions marché
et mis sac au dos, nous ne pouvions plus nous traîner.
Nous
croyions en arrivant à terre que nous avions très peu de
chemin à faire pour arriver à la caserne, mais la caserne
d'Orléans à la Basse-Terre était consignée
rapport aux fièvres. On nous emmena au Camp Jacob situé à
7 kilomètres de la Basse-Terre. Pour y arriver, il faut constamment
monter, toujours en tournant, car la Basse-Terre est au niveau de la mer
tandis que le Camp Jacob est élevé de 700 mètres au-dessus
du niveau de la mer. Depuis deux mois que nous n'avions marché
et mis sac au dos, nous ne pouvions plus nous traîner.
